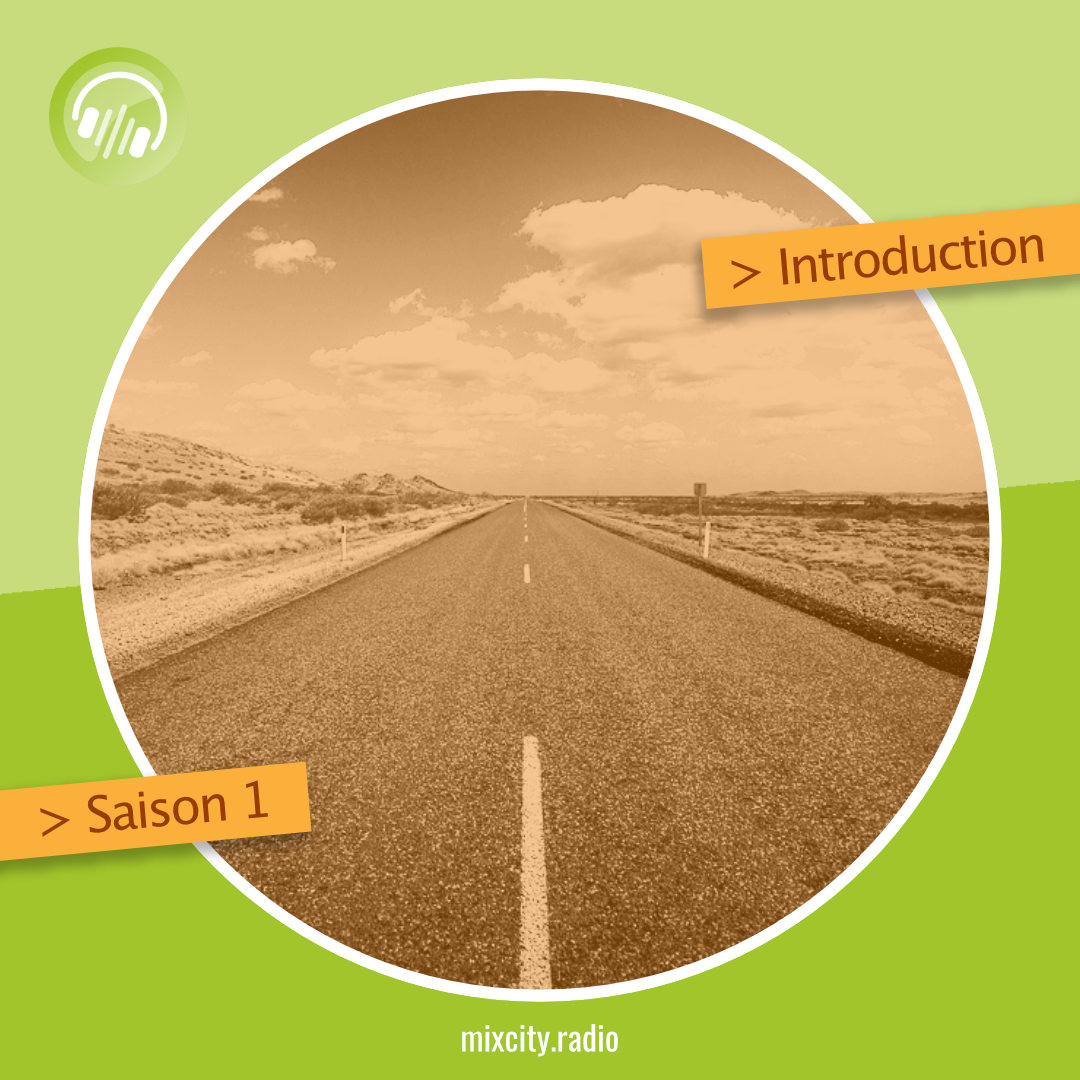C’est en furetant dans la bibliothèque d’une amie que je découvris il y a quelques années une partie de l’oeuvre de l’autrichien Stefan Zweig. Très vite, je me suis plongé dans les récits de cet écrivain-voyageur du 20ème siècle. Profitant d’un séjour cet été en Autriche, je décidai de partir sur les traces de ce grand humaniste et de cet auteur incontournable de la littérature du voyage. De Vienne où il est né à Salzbourg où il a vécu, le parcours fut facile à organiser. Seul restait le doute sur ce que j’allais y découvrir.
Préambule
Comme beaucoup de lecteurs francophones, je commençai mes lectures de Stefan Zweig par ses nouvelles les plus célèbres (« Le joueur d’échec« , « Amok« et « Lettre d’une inconnue« ). J’appris rapidement à aimer l’esprit humaniste de cet ardent défenseur de la culture européenne : de sa biographie sur Magellan à ses récits de voyage (« Pays, villes, paysages« ) en passant par son essai sur la découverte de l’Amérique (« Amerigo« ), il a su par la diversité de son oeuvre littéraire démontrer qu’il n’était pas seulement un auteur de nouvelles romantiques. Grand voyageur, il a traversé plusieurs continents de 1904 à 1942 : l’Europe bien sûr, mais aussi une partie de l’Amérique, de l’Asie et de l’Afrique. Un véritable tour du monde historique et littéraire, avec des récits de voyages qui sont autant d’invitations à la rencontre et à la compréhension de notre monde contemporain.
La Vienne d’hier… et d’aujourd’hui
« J’ai beaucoup voyagé, j’ai assisté à nombre de représentations remarquables (…) mais je dois l’avouer, jamais réalisations artistiques ne m’ont jamais autant bouleversé que celles de l’Opéra de Vienne dans les mois qui suivirent immédiatement l’effondrement de 1919. »
Si on reproche parfois à Stefan Zweig sa nostalgie de la « Grande Autriche », il faut bien avouer que ma première destination dans la capitale autrichienne tombait à pic : l’Opéra. Après avoir passé la nuit dans un vieux train allemand en provenance de Paris, mon taxi me déposa directement au pied de ce grand édifice du centre-ville. Majestueux sans être grandiloquent, je le contournai et me laissai guider intuitivement vers le centre Hofburg. L’endroit, cité dans tous les guides, est la destination favorite de bon nombre de voyageurs, tout particulièrement en ce début de mois d’août 2013. A aucun moment pourtant je n’eu l’impression d’être noyé dans la foule. Mieux, je profitai de ce début d’après-midi ensoleillé pour me laisser vivre à la terrasse d’un café situé devant les serres du Palais Impérial. La devise viennoise « vivre et laissez vivre » commençait à me séduire. Remontant les années, j’imaginais l’étudiant Zweig à la table voisine, une tasse d’Einspänner à la main, débattant avec ses compagnons estudiantins du dernier concert à la mode, contestant les défauts du maître de chapelle, argumentant sur la qualité de la représentation. J’imaginais aussi la vie estudiantine contemporaine, où les nombreux bancs et terrasses sont un moyen facile de profiter de la vie douce et romantique tant décrite dans les livres. Stefan Zweig aimait à dire de sa ville natale qu’elle était « agréable et facile. On y aimait les fêtes et les plaisirs ». Il disait vrai.
« Vienne est agréable et facile. On y aimait les fêtes et les plaisirs »
Mais Vienne est plus qu’un lieu de fête. Les différentes places de la cité impériale des Habsbourg (rappelez-vous « Sissi l’impératrice »), de l’Opéra ou encore du musée des Beaux Arts sont là pour rappeler au voyageur que Vienne fut pendant plusieurs siècles une des capitales culturelles majeure d’Europe. Car pour être touché par l’atmosphère viennoise, il faut se laisser conter l’histoire des génies de la musique qui ont animé la ville aux XVIIIème et XIXème siècles. Imaginez : Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Johann Strauss… Si ces artistes ne sont pas tous autrichiens, ils venaient à Vienne, selon Stefan Zweig, pour « sentir qu’ici le climat culturel était le plus propice à l’épanouissement de leur art ». Et c’est certainement pourquoi je me laissai si facilement séduire par la troupe Wiener Mozart en assistant à leur concert dans la salle dorée du mythique Musikverein (où le célèbre concert du nouvel an est donné chaque année). Là encore, Zweig n’avait pas menti : Vienne et ses habitants aiment la musique.
Sur les bords du Danube… l’inspiration
C’est en voiture que je quittai Vienne quelques jours plus tard pour Salzbourg. Si la traversée ne prend que quelques heures, j’avais décidé de passer trois jours dans l’arrière-pays. Passer d’une ville à l’autre me semblait précipité, et je dois avouer que l’attente de découvrir Salzbourg renforçait mon plaisir. Après quelques minutes d’autoroute (où les grosses cylindrées allemandes côtoient des files immenses de camions de frets), je pris la sortie de Melk. Si Stefan Zweig n’a pas vécu dans cette région (il en parle cependant dans ses récits de voyages), la quiétude des petites villes longeant le Danube me semblait toute indiquée pour m’imprégner de l’art de vivre de la campagne autrichienne. De l’impressionnant monastère de Melk à l’abbaye de Göttweig, des vieilles villes de Krems et Stein en passant par lemonastère de Wilhering, tout ici respire l’Histoire et la nature. Un lieu d’inspiration où des peintres viennent poser leur toile le long du Danube, et où de nombreux cyclistes affluent aux côtés des longues péniches. Au bout de deux jours, je quittai le Danube pour la région de Salzkammergut. Quelques kilomètres pour se rapprocher des zones montagneuses où trône le magnifique lac supérieur de Gosau. Un après-midi qui ponctua mon périple à travers la campagne de l’Autriche de l’Est. Le temps enfin de reprendre la route vers la ville d’adoption de Stefan Zweig : Salzbourg.
Salzbourg et la maison de Stefan Zweig
Ville natale de Mozart, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Salzbourg est aujourd’hui célèbre pour son festival international de la musique classique. Chaque été, la ville double en population et attire de nombreux touristes. Dans ses récits de voyages, Zweig ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son égard :
« Salzbourg offre un exemple tout à fait réussi de cette union aux trois éléments : la terre, l’eau, l’air. »
« La beauté d’une ville ne repose jamais sur son architecture exclusivement ; elle provient toujours d’une fusion particulière avec la nature. »
Et c’est bien la terre qui m’a frappé le plus quand je suis arrivé dans la ville par les routes du Sud. La montagne, prolongement des Alpes européennes, y est omniprésente. L’eau, avec le fleuve Salzach, sépare la cité des monts environnants. L’air enfin, avec les nombreux clochers du vieux centre, donne de la respiration à la torpeur estivale. Il était pourtant déjà tard quand j’arrivai à mon hôtel rue Schallmooser Hauptstraße, mais un bien-être naissant en moi augurait de belles surprises pendant les deux journées qui allaient suivre.
C’est donc le lendemain, aux premières heures d’un beau matin d’août, que je découvris complètement par hasard l’entrée de la Stefan Zweig Weg, la rue portant le nom de l’écrivain-voyageur dont je suivais la trace depuis plusieurs jours. Si les attractions liées à Mozart sont largement décrites dans les guides touristiques, il faut bien reconnaître que l’emplacement de la rue et de la villa où vécut Zweig nécessitent de faire quelques recherches. Rue escarpée aux trottoirs étroits, je montai avec une impatience visible cette voie menant au sommet de la « colline douce » du Kapuzinerberg. Car oui, j’étais impatient de découvrir le lieu où l’auteur de « Magellan » avait écrit une partie de son oeuvre littéraire entre deux voyages, impatient de m’assoir à proximité du petit château du Franziskischlössl et d’admirer moi aussi la citadelle en contre-bas.
En haut, au bout du chemin, un monastère. Deux moines me sourient et m’invitent dans leur cour pour admirer la vue panoramique sur la ville. Il fait beau. Le lieu est paisible. Le silence est une musique. Les minutes passent et je souris, heureux d’être là. Je contourne ensuite le monastère puis longe le parc. Quelques touristes vagabondent. Leurs regards furètent vers la vallée. Ils ne remarquent pas la clôture. Ils ne distinguent pas les murs jaunes au loin. Ils ne s’approchent pas quand la végétation s’éclaircit, ne cherchent pas à entrevoir. Ils ne la voient pas et pourtant elle bien là. La maison de Stefan Zweig. Pour eux, elle est cachée. Pour moi, elle est un symbole. Elle est le repos d’un écrivain-voyageur qui aimait reprendre des forces avant de partir vers d’autres destinations, elle est une partie de la culture humaniste du XXème siècle, un lieu de travail et de recueillement, la vision d’un vieux rêve. Elle est aussi et surtout la fin de mon voyage, l’aboutissement d’un formidable périple autrichien : sur les traces de Stefan Zweig.